La fable des abeilles ou les fripons devenus honnêtes gens
Un nombreux
essaim d’abeilles habitait une ruche spacieuse. Là, dans une heureuse abondance,
elles vivaient tranquilles. Ces mouches, célèbres par leurs lois, ne l’étaient
pas moins par le succès de leurs armes, et par la manière dont elles se multipliaient.
Leur domicile était un séminaire parfait de science et d’industrie. Jamais abeilles
ne vécurent sous un plus sage gouvernement : cependant, jamais il n’y en
eut de plus inconstantes et de moins satisfaites. Elles n’étaient, ni les malheureuses
esclaves d’une dure tyrannie, ni exposées aux cruels désordres de la
féroce démocratie. Elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient
errer, parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois.
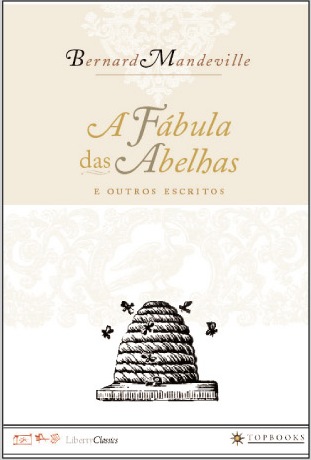 Ces
insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l’armée ou au barreau, vivaient
parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu’en petit, toutes leurs
actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l’adresse incomparable de leurs
petits membres, échappaient à la faible vue des humains : cependant il
n’est parmi nous, ni machine, ni ouvriers, ni métiers, ni vaisseaux, ni citadelles,
ni armes, ni artisans, ni ruses, ni science, ni boutiques, ni instruments, en
un mot, il n’y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux
industrieux ne se servissent aussi. Comme donc leur langage nous est inconnu,
nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu’en employant nos expressions.
L’on convient assez généralement qu’entre autres choses dignes d’être remarquées,
ces animaux ne connaissaient point l’usage des cornets ni des dés ; mais
puisqu’ils avaient des rois, et par conséquent des gardes, on peut naturellement
présumer qu’ils connaissaient quelque espèce de jeux. Vit-on en effet jamais
d’officiers et de soldats qui s’abstînssent de cet amusement ?
Ces
insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l’armée ou au barreau, vivaient
parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu’en petit, toutes leurs
actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l’adresse incomparable de leurs
petits membres, échappaient à la faible vue des humains : cependant il
n’est parmi nous, ni machine, ni ouvriers, ni métiers, ni vaisseaux, ni citadelles,
ni armes, ni artisans, ni ruses, ni science, ni boutiques, ni instruments, en
un mot, il n’y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux
industrieux ne se servissent aussi. Comme donc leur langage nous est inconnu,
nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu’en employant nos expressions.
L’on convient assez généralement qu’entre autres choses dignes d’être remarquées,
ces animaux ne connaissaient point l’usage des cornets ni des dés ; mais
puisqu’ils avaient des rois, et par conséquent des gardes, on peut naturellement
présumer qu’ils connaissaient quelque espèce de jeux. Vit-on en effet jamais
d’officiers et de soldats qui s’abstînssent de cet amusement ?
La fertile
ruche était remplie d’une multitude prodigieuse d’habitants, dont le grand nombre
contribuait même à la prospérité commune. Des millions étaient occupés à satisfaire
la vanité et l’ambition d’autres abeilles, qui étaient uniquement employées
à consumer les travaux des premières. Malgré une si grande quantité d’ouvriers,
les désirs de ces abeilles n’étaient pas satisfaits. Tant d’ouvriers, tant de
travaux, pouvaient à peine fournir au luxe de la moitié de la nation.
Quelques-uns,
avec de grands fonds et très peu de peines, faisaient des gains très considérables.
D’autres, condamnés à manier la faux et la bêche, ne gagnaient leur vie qu’à
la sueur de leur visage et en épuisant leurs forces par les occupations les
plus pénibles. L’on en voyait cependant d’autres qui s’adonnaient à des emplois
tout mystérieux, qui ne demandaient ni apprentissage, ni fonds, ni soins.
Tels étaient les chevaliers d’industrie, les parasites, les courtiers d’amour,
les joueurs, les filous, les faux-monnayeurs, les empiriques, les devins et,
en général tous ceux qui haïssant la lumière tournaient par de sourdes pratiques
à leur avantage, le travail de leurs voisins ? Qui incapables eux-mêmes
de tromper étaient moins défiants. On appelait ces gens-là des fripons :
mais ceux dont l’industrie était plus respectée, quoique dans le fond peu
différents des premiers, recevaient un nom plus honorable. Les artisans de chaque
profession, tous ceux qui exerçaient quelque emploi, ou quelque charge, avaient
quelque espèce de friponnerie qui leur était propre. C’était les subtilités
de l’art, et les tours de bâton.
Comme s’ils
n’eussent pu, sans l’instruction d’un procès, distinguer le légitime d’avec
l’illégitime, ils avaient des jurisconsultes occupés à entretenir des
animosités, et à susciter de mauvaises chicanes. C’était le fin de leur art.
Les lois leur fournissaient des moyens pour ruiner leurs parties et pour profiter
adroitement des biens engagés. Uniquement attentifs à tirer de précieux honoraires,
ils ne négligeaient rien pour empêcher qu’on ne terminât par voie d’accommodement
les difficultés. Pour défendre une mauvaise cause, ils épluchaient les lois
avec la même exactitude et dans le même but que les voleurs examinent les maisons
et les boutiques. C’était uniquement pour découvrir l’endroit faible dont ils
pourraient se prévaloir.
Les médecins
préféraient la réputation à la science, et les richesses au rétablissement de
leurs malades. La plupart, au lieu de s’appliquer à l’étude des règles de l’art,
s’étudiaient à prendre une démarche composée. Des regards graves, un air pensif,
étaient tout ce qu’ils possédaient pour se donner la réputation de gens doctes.
Tranquilles sur la santé des patients, ils travaillaient seulement à acquérir
les louanges des accoucheuses, des prêtres, et de tous ceux qui vivaient du
produit des naissances ou des funérailles. Attentifs à ménager la faveur du
sexe babillard, ils écoutaient avec complaisance les vieilles recettes de la
tante de Madame. Les chalands et toute leur famille étaient soigneusement ménagés.
Un sourire affecté, des regards gracieux, tout était mis en usage et servait
à captiver ces esprits déjà prévenus. Il n’y avait pas même jusques aux gardes
dont ils ne souffrirent les impertinences.
Entre le grand nombre des Prêtres de Jupiter, gagés pour
attirer sur la ruche la bénédiction d’en haut, il n’y en avait que bien
peu qui eussent de l’éloquence et du savoir. La plupart étaient même aussi emportés
qu’ignorants. On découvrait leur paresse, leur incontinence, leur avarice et
leur vanité, malgré les soins qu’ils prenaient pour dérober aux yeux du public
ces défauts. Ils étaient fripons comme des tailleurs, et intempérants comme
des matelots. Quelques-uns à face blême, couverts d’habits déchirés, priaient
mystiquement pour avoir du pain. Ils espéraient de recevoir de plus grosses
récompenses ; mais à la lettre ils n’obtenaient que du pain. Et tandis
que ces sacrés esclaves mouraient de faim, les fainéants pour qui ils officiaient
étaient bien à leur aise. On voyait sur leurs visages de prospérité, la santé
et l’abondance dont ils jouissaient.
Les soldats
qui avaient été mis en fuite, étaient comblés d’Honneur, s’ils avaient le bonheur
d’échapper à l’épée victorieuse, quoiqu’il y en eut plusieurs qui fussent de
vrais poltrons, qui n’aimaient point le carnage. Si quelque vaillant général
mettait en déroute les ennemis, il se trouvait quelque personne qui, corrompue
par des présents, facilitait leur retraite. Il y avait des guerriers qui affrontant
le danger, paraissaient toujours dans les endroits les plus exposés. D’abord
ils y perdaient une jambe, ensuite ils y laissaient un bras, et enfin, lorsque
toutes ces diminutions les avaient mis hors d’état de servir, on les renvoyait
honteusement à la demi-paye ; tandis que d’autres, qui plus prudents n’allaient
jamais au combat, tiraient la double paye, pour rester tranquilles chez eux.
Leurs Rois
étaient à tous égards mal servis. Leurs propres Ministres les trompaient. Il
y en avait à la vérité plusieurs qui ne négligeaient rien pour avancer les intérêts
de la couronne ; mais en même temps ils pillaient impunément le trésor
qu’ils travaillaient à enrichir. Ils avaient l’heureux talent de faire une très
belle dépense, quoique leurs appointements fussent très chétifs ; et encore
se vantaient-ils d’être fort modestes. Donnaient-ils trop d’étendue à leurs
droits ? ils appelaient cela leurs tours de bâton. Et même s’ils
craignaient qu’on ne comprît leur jargon, ils se servaient du terme d’Emoluments,
sans qu’ils voulussent jamais parler naturellement et sans déguisement de leurs
gains.
Car il n’y
avait pas une abeille qui ne se fut très bien contentée, je ne dis pas de ce
que gagnaient effectivement ces ministres, mais seulement de ce qu’ils laissaient
paraître de leurs gains. Ils ressemblaient à nos joueurs qui, quoiqu’ils aient
joué beau jeu, ne diront cependant jamais en présence des perdants tout ce qu’ils
ont gagné.
Qui pourrait
détailler toutes les fraudes qui se commettaient dans cette ruche ?
Celui qui achetait des immondices pour engraisser son pré, les trouvait falsifiés
d’un quart de pierres et de mortier inutiles et encore, quoique dupe, il n’aurait
pas eu bonne grâce d’en murmurer, puisqu’à son tour il mêlait parmi son beurre
une moitié de sel.
La justice
même, si renommée pour sa bonne foi quoiqu’aveugle, n’en était pas moins sensible
au brillant éclat de l’or. Corrompue par des présents, elle avait souvent fait
pencher la balance qu’elle tenait dans sa main gauche. Impartiale en apparence,
lorsqu’il s’agissait d’infliger des peines corporelles, de punir des meurtres
et d’autres grands crimes, elle avait même souvent condamné au supplice des
gens qui avaient continué leurs friponneries après avoir été punis du pilori.
Cependant on croyait communément que l’épée qu’elle portait ne frappait que
les abeilles qui étaient pauvres et sans ressources ; et que même cette
déesse faisait attacher à l’arbre maudit des gens qui, pressés par la fatale
nécessité, avaient commis des crimes qui ne méritaient pas un pareil traitement.
Par cette injuste sévérité, on cherchait à mettre en sûreté le grand et le riche.
Chaque ordre
était ainsi rempli de vices, mais la Nation même jouissait d’une heureuse prospérité.
Flattée dans la paix, on la craignait dans la guerre. Estimée chez les étrangers,
elle tenait la balance des autres ruches. Tous ses membres à l’envi prodiguaient
pour sa conservation leurs vies et leurs biens. Tel était l’état florissant
de ce peuple. Les vices des particuliers contribuaient à la félicité publique.
Dès que la vertu, instruite par les ruses politiques, eut appris mille heureux
tours de finesse, et qu’elle se fut liée d’amitié avec le vice, les plus scélérats
faisaient quelque chose pour le bien commun.
Les fourberies
de l’Etat conservaient le tout, quoique chaque citoyen s’en plaignît. L’harmonie
dans un concert résulte d’une combinaison de sons qui sont directement opposés.
Ainsi les membres de la société, en suivant des routes absolument contraires,
s’aidaient comme par dépit. La tempérance et la sobriété des uns facilitait
l’ivrognerie et la gloutonnerie des autres. L’avarice, cette funeste racine
de tous les maux, ce vice dénaturé et diabolique, était esclave du noble défaut
de la prodigalité. Le luxe fastueux occupait des millions de pauvres. La vanité,
cette passion si détestée, donnait de l’occupation à un plus grand nombre encore.
L’envie même et l’amour-propre, ministres de l’industrie, faisaient fleurir
les arts et le commerce. Les extravagances dans le manger et dans la diversité
de mets, la somptuosité dans les équipages et dans les ameublements, malgré
leur ridicule, faisaient la meilleure partie du négoce.
Toujours
inconstant, ce peuple changeait de lois comme de modes. Les règlements qui avaient
été sagement établis étaient annulés et on leur en substituait bientôt de tout
opposés. Cependant en altérant ainsi leurs anciennes lois et en les corrigeant,
ils prévenaient des fautes qu’aucune prudence n’aurait pu prévoir.
C’est ainsi
que le vice produisant la ruse, et que la ruse se joignant à l’industrie, on
vit peu à peu la ruche abonder de toutes les commodités de la vie. Les plaisirs
réels, les douceurs de la vie, l’aise et le repos étaient devenus des biens
si communs que les pauvres mêmes vivaient plus agréablement alors que les riches
ne le faisaient auparavant. On ne pouvait rien ajouter au bonheur de cette société.
Mais hélas !
quelle n’est pas la vanité de la félicité des pauvres mortels ? A peine
ces abeilles avaient-elles goûté les prémices du bonheur, qu’elles éprouvèrent
qu’il est même au dessus du pouvoir des Dieux de rendre parfait le séjour terrestre.
La troupe murmurante avait souvent témoigné qu’elle était satisfaite du gouvernement
et des ministres ; mais au moindre revers, elle changea d’idées. Comme
si elle eût été perdue sans retour, elle maudit les politiques, les armées et
les flottes. Ces Abeilles réunissant leurs plaintes, on entendait de tous côtés
ces paroles : Maudites soient toutes les fourberies qui règnent parmi
nous. Cependant chacune se les permettait encore ; mais chacune avait
la cruauté de ne vouloir point en accorder l’usage aux autres.
Un personnage
qui avait amassé d’immenses richesses en trompant son Maître, le Roi
et le Pauvre, osait crier de toute sa force : Le pays ne
peut manquer de périr pour toutes ses injustices. Et qui pensez-vous que
fut ce rigide sermonneur ? C’était un gantier qui avait vendu toute sa
vie et qui vendait actuellement des peaux de mouton pour des cabrons. Il ne
faisait pas la moindre chose dans cette société qui ne contribuât au bien public.
Cependant tous les fripons criaient avec impudence : Bon Dieux !
accordez-nous seulement la probité.
Mercure,
le dieu des voleurs, ne put s’empêcher de rire à l’ouïe d’une prière si effrontée.
Les autres Dieux dirent qu’il y avait de la stupidité à blâmer ce que l’on aimait.
Mais Jupiter, indigné de ces prières, jura enfin que cette troupe criailleuse
serait délivrée de la fraude dont elle se plaignait.
Il dit : Au même instant l’honnêteté s’empara de tous les cœurs. Semblable
à l’arbre instructif, elle dévoila les yeux de chacun, elle leur fit apercevoir
ces crimes qu’on ne peut contempler sans honte. Ils se confessaient coupables
par leurs discours et surtout par la rougeur qu’excitait sur leurs visages l’énormité
de leurs crimes. C’est ainsi que les enfants qui veulent cacher leurs fautes,
trahis par leur couleur, s’imaginent que dès qu’on les regarde, on lit sur leur
visage mal assuré la mauvaise action qu’ils ont faite.
Mais grand
Dieux ! quelle consternation ! quel subit changement ! En moins
d’une heure le prix des denrées diminua partout. Chacun, depuis le Ministre
d’Etat jusqu’au Villageois arracha le masque d’hypocrisie qui le couvrait.
Quelques-uns, qui étaient très bien connus auparavant, parurent des étrangers
quand ils eurent pris des manières naturelles.
Dès ce moment,
le Barreau fut dépeuplé. Les débiteurs acquittaient volontairement leurs dettes,
sans en excepter même celles que leurs créditeurs avaient oubliées. On les cédait
généreusement à ceux qui n’étaient pas en état de les satisfaire. S’élevait-il
quelque difficulté, ceux qui avaient tort restaient modestement dans le silence.
On ne voyait plus de procès où il entrât de la mauvaise foi et de la vexation.
Personne ne pouvait plus acquérir des richesses. La vertu et l’honnêteté régnaient
dans la Ruche. Qu’est-ce donc que les avocats y auraient fait ?
Aussi tous ceux qui avant la révolution n’avaient pas eu le bonheur de gagner
du bien, désespérés ils pendaient leur écritoire à leur côté et se retiraient.
La justice,
qui jusqu’alors avait été occupée à faire pendre certaines personnes, avait
donné la liberté à ceux qu’elle tenait prisonniers. Mais dès que les prisons
eurent été nettoyées, la déesse qui y préside devenant inutile, elle se fit
contraint de se retirer avec son train et tout son bruyant attirail. D’abord
paraissaient quelques SERRURIERS chargés de serrures, de verrous, de grilles,
de chaînes et de portes garnies de barres de fer. Ensuite venaient les Geôliers,
les GUICHETIERS et leurs suppôts. La déesse paraissait alors précédée de son
fidèle ministre l’écuyer Carnifex, le grand exécuteur de ses ordres sévères.
Il n’était point armé de son épée imaginaire (l'épée du bourreau ne sert pas,
il se sert en Angleterre de sa seule hache pour la décapitation), à la place
il portait la hache et la corde. Dame Justice aux yeux bandés, assise sur un
nuage, fut chassée dans les airs accompagnée de ce cortège. Autour de son char
et derrière il y avait ses sergents, huissiers, et ses domestiques de toute
espèce qui se nourrissent des larmes des infortunés.
La RUCHE
avait des MEDECINS, tout comme avant la révolution. Mais la médecine, cet art
salutaire, n’était plus confiée qu’à d’habiles gens. Ils étaient en si grand
nombre, et si bien répandus dans la ruche qu’ils n’y en avait aucun qui eut
besoin de se servir de voiture. Leurs vaines disputes avaient cessé. Le soin
de délivrer promptement les patients était ce qui les occupait uniquement. Pleins
de mépris pour les drogues qu’on apporte des pays étrangers, ils se bornaient
aux simples que produit le pays. Persuadés que les Dieux n’envoient aucune maladie
aux Nations sans leur donner en même temps les vrais remèdes, ils s’attachaient
à découvrir les propriétés des plantes qui croissaient chez eux.
LES RICHES
ECCLESIASTIQUES, revenus de leur honteuse paresse ne faisaient plus desservir
leurs églises par des abeilles prises à la journée. Ils officiaient eux-mêmes.
La probité dont ils étaient animés les engageait à offrir des prières et des
sacrifices. Tous ceux qui ne se sentaient pas capables de s’acquitter de ces
devoirs ou qui croyaient qu’on pouvait se passer de leurs soins, résignaient
sans délai leurs emplois. Il n’y avait pas assez d’occupation pour tant de personnes,
si même il en restait pour quelques-uns. Le nombre en diminua donc considérablement.
Ils étaient tous modestement soumis au GRAND PRETRE, qui uniquement occupé des
affaires religieuses, abandonnait aux autres les affaires d’Etat. Le chef sacré,
devenu charitable, n’avait pas la dureté de chasser de sa porte les pauvres
affamés. Jamais on n’entendait dire qu’il retranchât quelque chose du salaire
de l’indigent. C’était au contraire chez lui que l’affamé trouvait de la nourriture,
le mercenaire du pain, l’ouvrier nécessiteux sa table et son lit.
Le changement
ne fut pas moins considérable parmi les premiers ministres du roi et tous les
officiers subalternes. Economes et tempérants alors, leurs pensions leur
suffisaient pour vivre. Si une pauvre Abeille fut venue dix fois pour demander
le juste paiement d’une petite somme, et que quelques Commis bien payé l’eut
obligé, ou de lui faire présent d’un écu, ou de ne jamais recevoir son paiement,
on aurait ci-devant appelé une pareille alternative, le tour de bâton du
commis ; mais pour lors on lui aurait tout naturellement donné le nom
de friponnerie manifeste.
Une SEULE
Personne suffisait pour remplir les places qui en exigeaient trois avant l’heureux
changement. On n’avait plus besoin de donner des collègues pour éclairer les
actions de ceux à qui l’on confiait le maniement des affaires. Les magistrats
ne se laissaient plus corrompre ? et ils ne cherchaient plus à faciliter
les larcins des autres. Un seul faisait alors mille fois plus d’ouvrage que
plusieurs n’en faisaient auparavant.
Il n’y avait
plus d’honneur à faire figure aux dépens de ses créditeurs. Les Livrées étaient
pendues dans les boutiques des Fripiers. Ceux qui brillaient par la magnificence
de leurs carrosses les vendaient pour peu de chose. La noblesse se défaisait
de tous ses superbes chevaux si bien appariés, et même de leurs campagnes pour
payer leurs dettes.
On évitait
la vaine dépense avec le même soin qu’on fuyait la fraude. On n’entretenait
plus d’Armée dehors. Méprisant l’estime des étrangers, et la gloire frivole
qui s’acquiert par les armes, on ne combattait plus que pour défendre la patrie
contre ceux qui en voulaient à ses droits et à sa liberté.
 Jetez
présentement les yeux sur la ruche glorieuse. Contemplez l’accord admirable
qui règne entre les commerces et la bonne foi. Les obscurités qui couvraient
ce spectacle ont disparu. Tout se voit à découvert. Que les choses ont changé
de face !
Jetez
présentement les yeux sur la ruche glorieuse. Contemplez l’accord admirable
qui règne entre les commerces et la bonne foi. Les obscurités qui couvraient
ce spectacle ont disparu. Tout se voit à découvert. Que les choses ont changé
de face !
Ceux qui faisaient des dépenses excessives et tous ceux qui vivaient de ce luxe
furent forcés de se retirer. En vain ils tentèrent de nouvelles occupations ;
elles ne purent leur fournir le nécessaire.
Le prix des fonds et des bâtiments tomba. Les palais enchantés dont les murs
semblables à ceux de Thèbes avaient été élevés par la musique, étaient
déserts. Les grands qui auraient mieux aimé perdre la vie que de voir effacer
les titres fastueux gravés sur leurs superbes portiques, se moquaient aujourd’hui
de ces vaines inscriptions. L’architecture, cet art merveilleux, fut entièrement
abandonné. Les artisans ne trouvaient plus personne qui voulut les employer.
Les peintres ne se rendaient plus célèbres par leur pinceau. Le sculpteur, le
graveur, le ciseleur et le statuaire n’étaient plus nommés dans la Ruche.
Le peu d’abeilles qui restèrent vivaient chétivement. On n’était plus en peine
comment on dépenserait son argent, mais comment on s’y prendrait pour vivre.
En payant leur compte à la taverne, elles prenaient la résolution de n’y remettre
jamais le pied. On ne voyait plus de salope cabaretière qui gagnât assez pour
porter des habits de drap d’or. Torcol ne donnait plus de grosses sommes
pour avoir du Bourgogne et des ortolans. Le courtisan qui se piquant de régaler
le jour de Noël sa maîtresse de pois verts, dépensait en deux heures
autant qu’une compagnie de cavalerie aurait dépensé en deux jours, plia bagage,
et se retira d’un si misérable pays.
La fière
Cloé dont les grands airs avaient autrefois obligé son trop facile mari de piller
l’Etat, vend à présent son équipage composé des plus riches dépouilles des Indes.
Elle retranche sa dépense et porte toute l’année le même habit. Le siècle léger
et changeant est passé. Les modes ne se succèdent plus avec cette bizarre inconstance.
Dès lors, tous les ouvriers qui travaillaient les riches étoffes de soie et
d’argent et tous les artisans qui en dépendent, se retirent. Une paix profonde
règne dans ce séjour ; elle a à sa suite l’abondance. Toutes les manufactures
qui restent ne fabriquent que des étoffes les plus simples ; cependant
elles sont toutes fort chères. La nature bienfaisante n’étant plus contrainte
par l’infatigable jardinier, elle donne, à la vérité, ses fruits dans sa saison ;
mais aussi elle ne produit plus ni raretés, ni fruits précoces.
A mesure
que la vanité et le luxe diminuaient, on voyait les anciens habitants quitter
leur demeure. Ce n’était plus ni les marchands, ni les compagnies qui faisaient
tomber les manufactures, c’était la simplicité et la modération de toutes les
abeilles. Tous les métiers et tous les arts étaient négligés. Le contentement,
cette peste de l’industrie, leur fait admirer leur grossière abondance. Ils
ne recherchent plus la nouveauté, ils n’ambitionnent plus rien.
C’est ainsi
que la ruche étant presque déserte, ils ne pouvaient se défendre contre les
attaques de leurs ennemis cent fois plus nombreux. Ils se défendirent cependant
avec toute la valeur possible, jusqu’à ce que quelques-uns d’entre eux eussent
trouvé une retraite bien fortifiée. C’est là qu’ils résolurent de s’établir
ou de périr dans l’entreprise. Il n’y eut aucun traître parmi eux. Tous combattirent
vaillamment pour la cause commune. Leur courage et leur intégrité furent enfin
couronnés de la victoire.
Ce triomphe
leur coûta néanmoins beaucoup. Plusieurs milliers de ces valeureuses abeilles
périrent. Le reste de l’essaim, qui s’était endurci à la fatigue et aux travaux,
crut que l’aise et le repos qui mettait si fort à l’épreuve leur tempérance,
était un vice. Voulant donc se garantir tout d’un coup de toute rechute, toutes
ces abeilles s’envolèrent dans le sombre creux d’un arbre où il ne leur reste
de leur ancienne félicité que le Contentement et l’Honnêteté.
Quittez
donc vos plaintes, mortels insensés ! En vain vous cherchez à associer
la grandeur d’une Nation avec la probité. Il n’y a que des fous qui puissent
se flatter de jouir des agréments et des convenances de la terre, d’être renommés
dans la guerre, de vivre bien à son aise et d’être en même temps vertueux. Abandonnez
ces vaines chimères. Il faut que la fraude, le luxe et la vanité subsistent,
si nous voulons en retirer les doux fruits. La faim est sans doute une incommodité
affreuse. Mais comment sans elle pourrait se faire la digestion d’où dépend
notre nutrition et notre accroissement. Ne devons-nous pas le vin, cette excellent
liqueur, à une plante dont le bois est maigre, laid et tortueux ? Tandis
que ses rejetons négligés sont laissés sur la plante, ils s’étouffent les uns
les autres et deviennent des sarments inutiles. Mais si ces branches sont étayées
et taillées, bientôt devenus fécondes, elles nous font part du plus excellent
des fruits.
C’est ainsi que l’on trouve le vice avantageux, lorsque la justice l’émonde,
en ôte l’excès, et le lie. Que dis-je ! Le vice est aussi nécessaire dans
un Etat florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il
est impossible que la vertu seule rende jamais une Nation célèbre et glorieuse.
Pour y faire revivre l’heureux Siècle d’Or, il faut absolument outre l’honnêteté
reprendre le gland qui servait de nourriture à nos premiers pères.
Bernard
MANDEVILLE, La Fable des abeilles
Londres : Aux dépens de la
Compagnie, 1740 Traduction de Jean Bertrand p. 1/26 Gallica
1.
En quoi la société des abeilles est-elle d'abord friponne, illustrez.
2. Expliquez le passage en italique
d'après le principe de la main invisible.
Les
vices expliquent Mandeville sont les moteurs de la vie sociale. Il emprunte la
définition du vice directement a son adversaire direct, Shaftesbury, qui avait
développé ce qu’on appelle aujourd’hui une « morale du sentiment ».
Le vice consiste pour Shaftesbury à faire passer son intérêt privé avant l’intérêt
général. La vertu, au contraire, rapproche et unit les intérêts particuliers et
l’intérêt général. Le vice, c’est l’action égoïste. Mandeville répond :
Les actions humaines sont égoïstes, même si les hommes ne sont pas insatiables.
Les vices produisent une certaine forme de sociabilité, que l’on doit à l’intérêt.
Au fond, l’intérêt n’est pas dissociant. Les êtres humains s’associent parce que
leur intérêt est de le faire, et non pas parce que la Providence a déposé en eux
l’amour d’autrui, ou le sens de l’intérêt général.
Quand on se demande
si l’harmonie est naturelle ou artificielle, Hayek répond qu’elle n’est ni l’une
ni l’autre. Elle n’est pas naturelle puisqu’elle dépend de l’action des hommes,
elle n’est pas non plus artificielle, car elle ne réalise pas un dessein ni un
projet volontaire. L’harmonie est un ordre résultant, et Hayek reprend l’expression
d’un philosophe écossais, ami de Adam Smith, Adam Ferguson : « le
résultat de l’action des hommes, mais non de leurs dessein ». Cette formule
de Ferguson résume toute la Fable des Abeilles de Mandeville.
3. Pourquoi la ruche honnête est-elle
menée à la ruine ? Etablissez-en un rapport entre richesse et besoins.
Aussitôt
les activités économiques florissantes périclitent. Les prisonniers sont libérés,
car la délinquance n’existe plus, mais cela n’arrange pas les affaires de la confrérie
des serruriers, qui défilent en revendiquant, car on n’a plus besoin de leurs
serrures. Les médecins n’ont plus de patients, car sans dégradation des mœurs,
chacun mène une vie saine, hygiénique, les gens ne sont plus malades. Les policiers,
les militaires, sont au chômage, les pauvres n’ont plus de bienfaiteurs, car il
n’existe plus de riches, et finalement la ruche perd ses membres, elle s’étiole,
et les dernières abeilles décident de l’abandonner et de vivre dans un coin d’arbre.
Elles n’ont plus rien.
4. Les besoins que nous éprouvons
sont-ils limités, sont-ils nécessairement fondés sur le vice ?
5. Les sociétés riches sont-elles
plus corrompues que les sociétés pauvres ?
6.
Quelle vision a Mandeville des besoins de l'individu ? Discutez-en.
On montrera qu'une société de confiance
est un préalable à la prospérité. On discutera de la vision que possède Mandeville
des besoins individuels, on mettra cette vision en parallèle avec la vision normative
qu'en ont les donneurs de leçons et les censeurs contemporains...
Réponses
d'après Eric Oudin, tiré du site Libéralia

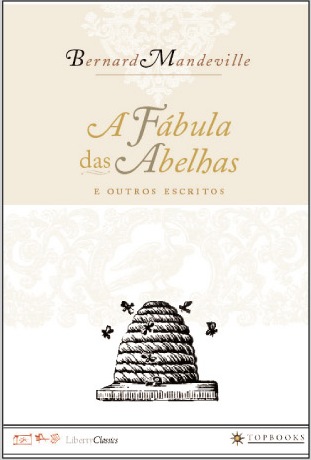 Ces
insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l’armée ou au barreau, vivaient
parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu’en petit, toutes leurs
actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l’adresse incomparable de leurs
petits membres, échappaient à la faible vue des humains : cependant il
n’est parmi nous, ni machine, ni ouvriers, ni métiers, ni vaisseaux, ni citadelles,
ni armes, ni artisans, ni ruses, ni science, ni boutiques, ni instruments, en
un mot, il n’y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux
industrieux ne se servissent aussi. Comme donc leur langage nous est inconnu,
nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu’en employant nos expressions.
L’on convient assez généralement qu’entre autres choses dignes d’être remarquées,
ces animaux ne connaissaient point l’usage des cornets ni des dés ; mais
puisqu’ils avaient des rois, et par conséquent des gardes, on peut naturellement
présumer qu’ils connaissaient quelque espèce de jeux. Vit-on en effet jamais
d’officiers et de soldats qui s’abstînssent de cet amusement ?
Ces
insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l’armée ou au barreau, vivaient
parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu’en petit, toutes leurs
actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l’adresse incomparable de leurs
petits membres, échappaient à la faible vue des humains : cependant il
n’est parmi nous, ni machine, ni ouvriers, ni métiers, ni vaisseaux, ni citadelles,
ni armes, ni artisans, ni ruses, ni science, ni boutiques, ni instruments, en
un mot, il n’y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux
industrieux ne se servissent aussi. Comme donc leur langage nous est inconnu,
nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu’en employant nos expressions.
L’on convient assez généralement qu’entre autres choses dignes d’être remarquées,
ces animaux ne connaissaient point l’usage des cornets ni des dés ; mais
puisqu’ils avaient des rois, et par conséquent des gardes, on peut naturellement
présumer qu’ils connaissaient quelque espèce de jeux. Vit-on en effet jamais
d’officiers et de soldats qui s’abstînssent de cet amusement ?